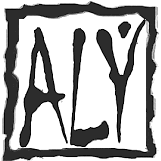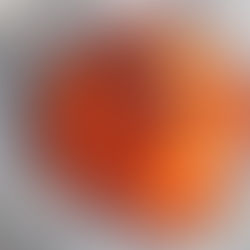Les argiles
Tous les céramistes (honnêtes) vous le diront, le contact de la terre humide, sa douceur lorsque son grain est fin, sa réactivité à la caresse ou à la pression offrent au sculpteur ou au potier des moments d’intimité et de sensualité proche de l’extase !
Ceci pour dire que ce matériau ductile, extrêmement plastique offre au créateur un univers de possibilités. Pour sa part, ALY s’en tient au côté brut de la matière, son grain, sa couleur selon qu’elle est cuite à grès ou simplement à biscuit, en oxydation ou en réduction, sa nervosité, sa capacité de fuite entre les doigts, ou au contraire sa relative dureté, sa rapidité de séchage, son aspect lorsqu’elle est lissée ou griffée… sont autant de contraintes, ou de qualités, qui viennent nourrir et étayer la créativité.
Le bronze à cire perdue
Le prix élevé du bronze tient à sa grande technicité et au nombre des métiers qui interviennent dans sa réalisation. Sans parler du travail de l’artiste dans la réalisation de son œuvre originale, (exemplaire qui peut être en argile cuite ou crue, en plâtre, en pierre même, ou en cire) de nombreux artisans au savoir-faire spécifique œuvrent à la réalisation d’un bronze.
Le moulage est la réalisation, autour de l’original, d’un moule en élastomère, va permettre le tirage d’une pièce en plusieurs exemplaires. Le bronzier se charge ensuite d’effectuer un premier tirage en cire de la pièce et d’y fixer le système complexe de jets et d’évents, c'est à dire le circuit d’alimentation et de « respiration » du futur bronze. Le métal en fusion doit pouvoir irriguer le moindre détail de la pièce. Pepino ROSINI dit de lui « à ce moment je me transforme en bronze liquide » !
Une coque, en plâtre réfractaire ou en céramique, est ensuite coulée ou pulvérisée autour du tirage en cire. Cette « coque » est cuite et le moule est déciré, il ne demeure alors plus que le « rêve » de la future pièce, son empreinte en creux… parfaitement vide. On parle alors de tirage à cire perdue. La coque est alors prête à recevoir le métal en fusion…. Moment magique. Une fois le moule refroidi, on peut procéder à son décochage, c'est à dire le décrochage de la coque de plâtre cuit. Le bronze avec son circuit d’alimentation est alors confié au ciseleur qui rapproche le bronze de son original, ôte le circuit d’alimentation, comble les manques ou ôte les surplus éventuels, brase, soude, meule.
Puis intervient le travail du patineur qui apposera, selon des formules assez secrètes d’atelier, des composés de divers acides et oxydes qui vont stabiliser durablement l’aspect final du bronze.
Le banko
Maintenant oubliez tout ce que vous venez de lire sur le bronze classique.
Commencez par fabriquer votre four ! Modelez votre pièce en cire, ajoutez quelques jets… un évent si vraiment vous pensez que le métal aura du mal à venir jusqu’au fond de la pièce. Et appliquez sur le tout plusieurs couches de banko, ce mélange traditionnel burkinabé de crottin d’âne, de sable et d’argile. Laissez sécher au soleil. Cuisez à feux doux, n’oubliez pas les tongues et la salive pour colmater les fissures éventuelles de la coque banko. Touillez le creuset, versez. C’est prêt. Reste la ciselure.
Vu de loin la technique ancestrale du banko produit cet effet là… tout semble si simple, presque enfantin. En réalité cette technique suppose la même maitrise du feu, de l’argile et la même science du métal que celle du chapitre précédent. Simplement les lignées de bronziers, les Dermé, les Traoré, les Touré remplacent la sécurité par la prudence, et la patience ; l’efficacité par l’ingéniosité, la quantité par l’unicité. La matrice (le rêve du bronze) est brisée à chaque pièce. Il n’y a pas de doublon, pas de filet. Ça doit venir et du premier coup. Aujourd’hui le savoir faire de ces artisans d’exception se répand, mais ils en demeurent les maîtres… et tant mieux.
Le tirage au sable
Un autre procédé de tirage du bronze est le tirage au sable. Réservé en principe aux pièces minces et de peu de relief (médailles, pièces de monnaies, protection de portes en laiton par exemple), cette technique peut aussi supporter des pièces plus conséquentes, dites à noyau. C’est la technique utilisée pour réaliser les médaillons et portes clés. Mais le 1er exemplaire de « Heaven » est aussi né d’une matrice en sable. Dans ce cas un sable de fonderie, mélange de sables très fins et d’huiles fines pétrolifères est tassé autour de l’épreuve originale, à l’intérieur d’un cadre en deux parties. La découpe de chaque moitié de cadre doit venir se superposer parfaitement à l’autre moitié sous peine de bavures et autres décrochages d’empreintes. S’ensuivent de nombreuses cogitations sur quelle partie va où… puis de nombreuses erreurs sur à quel moment appliquer une séparation de talc pour que la 1ère partie n’adhère pas à la seconde et à quel moment réaliser les puits d’alimentation et ou placer les évents…et enfin le miracle à lieu.
Ah oui j’oubliais…. Entre temps le bronze à été porté à 1250 °C.